Un moment clé de l'idéologie unilinguiste
À la fin du XVIIIe siècle, le français était considérée comme la principale langue de culture en Europe, la digne héritière du latin. Certes on lisait et on éditait encore, en France et à l’étranger, les poètes latins modernes, mais on n’écrivait plus de poésie latine, et on n’utilisait plus le latin dans le discours scientifique. L’Église elle-même, plus résistante aux changements, commençait à ressentir la nécessité d’implanter le français. Dans l’enseignement, qui dépendait en grande partie du clergé, le latin occupait encore une place privilégiée, mais durant la période révolutionnaire, le français va peu à peu le supplanter. C’est en outre la langue de la monarchie, de la justice, de l’État, l’un des traits distinctifs des nobles de la Cour et de la haute bourgeoisie, c’est pratiquement, enfin, la seule langue écrite en France depuis longtemps.
Mais le français était loin d’être la seule langue parlée en France. À cette époque le français était, comme l’attestent certains comptes rendus d’assemblées et de sociétés populaires, sinon une langue totalement étrangère pour une grande partie de la population, du moins une langue mal comprise et encore plus mal parlée. À côté d’une minorité qui n’utilisait que le français (oral et écrit), on doit supposer l’existence d’une catégorie d’usagers socialement hétérogène, qui pratiquaient un bilinguisme plus ou moins maîtrisé, et dont certains joueront un rôle important dans la communication politique qui commence, comme intermédiaires entre le pouvoir révolutionnaire et le peuple (Boyer 1990b : 46-52). La raison de cette situation linguistique résidait probablement dans l’isolement et la rareté des relations entre régions et provinces. À cela s’ajoute le problème des communications car certaines zones restaient à l’écart de toute circulation d’hommes, d’idées ou de marchandises et n’éprouvaient aucun besoin de sortir de leur isolement. Selon R. Balibar et D. Laporte, face à l’existence d’une langue d’élite (le français), le maintien de ces langues contribuait à entretenir la soumission des masses paysannes car ces langues constituaient de véritables barrières linguistiques qui réduisaient au minimum toute possibilité d’identification de classe avec le pouvoir (Balibar-Laporte1976 : 34-35). Un paysan qui sait lire et écrire abandonne l’agriculture : c’est peut-être l’argument que s’était donné l’Ancien Régime pour ne pas favoriser du tout l’instruction publique. Les écoles de l’époque étaient en fait des garderies où l’on élevait les enfants et les maîtres n’étaient pas rares qui ne savaient ni lire ni écrire. Le maître était un homme de chœur qui menait les enfants à l’église tous les matins et chantait à l’office ; l’enseignement de la lecture et de l’écriture n’était pas essentiel. L’enseignement dépendait en grande partie de l’Église et celle-ci exerçait ses fonctions différemment selon le groupe social auquel elle s’adressait. Dans les paroisses rurales et les paroisses de quartier, l’enseignement de la religion se faisait en "patois", seule langue à être comprise par le peuple, car il s’agissait de propager la foi.
La “ politique linguistique ” révolutionnaire
Si, avant 1789, la langue avait été l’objet de mesures occasionnelles et dispersées, elle devient, à la Révolution, une question capitale. Comme le rappelle Brunot (Brunot, 1967, t. IX, première partie, 91-107), entre le 14 janvier 1790 et septembre 1974, toute une série de mesures destinées à imposer le français sont prises : on peut donc parler, sans exagération, de politique linguistique. Alain Alcouffe et Ulrike Brummert distinguent deux orientations dans cette politique : l’une encourage la diffusion du français et a comme objectif de favoriser la propagation des idées révolutionnaires (traduction de décrets, de la Constitution, développement de l’enseignement du français...) ; l’autre concerne les mesures destinées à éradiquer les autres langues (allant jusqu’à ce que l’on désigne comme "terreur linguistique") ; la première a pour visée le bilinguisme, la seconde l’imposition d’une seule langue d’État, le français (Alcouffe - Brummert 1985). L’idéologie qui sous-tend ces mesures apparaît dans la bouche de Sylvain Maréchal, représentant des Jacobins :
La langue doit être une comme la République ; il faut que les paroles soient à l'unisson comme les coeurs. Hommes libres quittez le langage des esclaves. Admissibles à toutes les fonctions par vos droits de citoyens, instruisez‑vous pour en remplir les devoirs. La connaissance de la langue natale est la première science à vous procurer, il faut que la langue française vous soit aussi familière que la liberté. Un patriote doit savoir lire, écrire et parler la langue de son pays. Plus de patois, plus de jargons, qui jadis faisaient du peuple français cinq ou six nations étrangères l'une à l'autre ; point d'expressions basses ! [...]. Autrefois les despotes, les nobles, les riches et les prêtres n'étaient point fâchés d'entendre le peuple s'exprimer en termes grossiers ; eux, au contraire affectoient un idiome recherché, c'étoit comme une barrière aristocratique qu'ils élevoient entr'eux et le peuple. Mais aujourd'hui que nous sommes tous égaux, tous frères, parlons‑nous avec franchise et décence ; respectons‑nous dans nos discours comme dans notre maintien ! Il faut que le premier des Peuples soit en même temps celui qui parle le mieux (Tableau historique des événements révolutionnaires depuis la fondation de la République jusqu'à présent rédigé principalement pour les campagnes, au an III de la République, Duffard, imprimeur libraire, Paris (cité par Chauraud 1989a : 2).
C’est Brunot, dans son Histoire de la langue (Brunot 1967), qui réalise l’étude la plus poussée des mesures politiques prises en matière linguistique pendant la Révolution, et c’est lui que la plupart des analyses postérieures prennent comme référence ; ce sera aussi la nôtre, sans perdre de vue toutefois les critiques actuelles qui dénoncent son interprétation "jacobine" des faits ainsi que quelques erreurs chronologiques (Cf. entre autres, Alcouffe-Brummert 1985 et Vecchio 1989). La période analysée ci-dessous s’étend sur quatre ans à peine, au cours desquels sont prises des mesures qui seront présentées ici en trois groupes distincts mais étroitement liés. Le premier groupe comprend les mesures destinées à la diffusion des idées révolutionnaires, traductions, propagande, discours, sermons..., qui, pour des raisons pratiques, acceptent l’existence de la variété linguistique. Le deuxième groupe concerne les mesures destinées à diffuser le français, plans d’instruction publique, création d’écoles..., et visant à une meilleure compréhension des faits politiques par tous les citoyens. Ces mesures dérivent des nécessités de la communication qui exigeait une langue commune : le français était le meilleur candidat. Les mesures du troisième groupe sont très différentes : ce sont celles qui répriment les «patois» et/ou les «idiomes», considérés comme un danger pour la Révolution.
La première décision concernant les traductions est prise le 14 janvier 1790 : devant l’Assemblée, il est demandé que l’exécutif fasse publier tous les décrets dans tous les "idiomes" parlés en France, comme seul moyen d’entrer en contact avec ceux qui ignorent la langue française ;
Ainsi tout le monde va être le maître de lire et écrire dans la langue qu'il aimera mieux et les lois françaises seront familières à tout le monde
allègue un député de Bailleul (cité par Brunot 1967, t. IX, 1e partie : 25) : un an plus tard elle sera mise à exécution dans trente départements méridionaux (cf. Alcouffe - Brummert, 1985 et Schlieben-Lange, 1985). La politique de traduction sera reprise en 1792 : à cette occasion, on ne s’intéresse qu’à l’allemand, l’italien, le castillan, le basque et le bas-breton (on remarque une confusion, peut-être délibérée, entre le catalan et le castillan). Voici la première page de la Constitution traduite en occitan en 1792.
À côté de cette politique officielle, existent des pratiques orales de traduction ou de communication bilingue sur les documents des clubs et des sociétés. C’est ainsi que les "curés rouges" expliquent les décrets de l’Assemblée en "patois" et que les Sociétés populaires emploient le français et le "patois" dans leurs réunions.
Puis la politique de traduction cède le pas à la politique "jacobine" de la langue nationale. En raison de leur situation historico-linguistique, les "patois" ne sont pas en mesure de servir de véhicule aux idées politiques du moment (Schlieben-Lange 1985 : 102-103). Parmi les mesures destinées à diffuser le français, apparaissent les plans d’instruction. En 1791, Talleyrand expose le problème linguistique devant l’Assemblée en ces termes (10 septembre 1790) :
une singularité frappante de l'état dont nous sommes affranchis, dit‑il, est sans doute que la langue nationale, qui chaque jour étendait ses conquêtes au‑delà des limites de la France, soit restée au milieu de nous comme inaccessible à un si grand nombre de ses habitants, et que le premier lien de communication ait pu paraître, pour plusieurs de nos confrères, une barrière insurmontable. Une telle bizarrerie doit, il est vrai, son existence à diverses causes agissant fortuitement et sans dessein ; mais c'est avec réflexion, c'est avec suite que les effets ont été tournés contre le peuple. Les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité : la langue de la Constitution et des lois y sera enseignée à tous ; et cette foule de dialectes corrompus, dernier reste de la féodalité sera contrainte de disparaître ; la force des choses le commande (Assemblée Nationale, 10 sept. 1791, Rapport au nom du comité de constitution, par Talleyrand-Périgord, ancien évêque d'Autun, arch. parl. Ie série, XXX, p. 472. Cité par Brunot 1967, t. IX, 2e partie, 13-14).
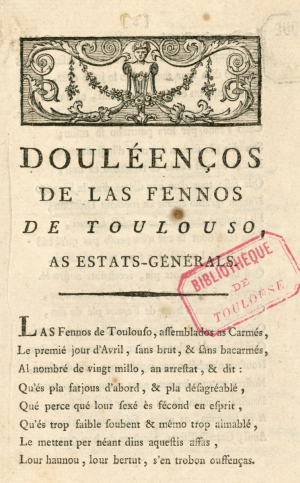
as Estats-Générals, Bibliothèque municipale
de Toulouse, 1789 (Rosalis)
Le 14 septembre 1790 est décrétée la création d’un comité d’instruction publique. Mais dans la réalité, les besoins d’une grande majorité de la population n’étaient même pas ceux d’une instruction en français, mais simplement d’un enseignement. La plupart des écoles avaient disparu en même temps que les privilèges ecclésiastiques, la destruction des ordres religieux, l’obligation de prêter serment, etc. Par ailleurs de nombreux instituteurs, tourmentés dans leur conscience, influencés par le clergé ou simplement privés de leur salaire, avaient abandonné leur poste sans être remplacés, si ce n’est par des schismatiques que le peuple refusait. En 1793, un décret ordonne la création des écoles primaires de l’État où l’on devait apprendre à lire, écrire et parler en français, ainsi que les principes révolutionnaires et quelques notions de géographie, de droit, etc. De nombreux projets d’instruction publique se succèdent : plans d’études, création d’établissements, formation des enseignants.
La politique linguistique se durcit lorsque les représentants en mission, envoyés dans les régions où les «idiomes » sont différents jugent que non seulement ces "idiomes" sont un obstacle passif aux progrès de la Révolution, mais qu’en outre ils constituent un foyer de résistance qui favorise la propagande contre-révolutionnaire. Le 27 janvier 1794, Barère, au nom du Comité de Salut Public, monte à la tribune pour dénoncer, dans son Rapport du Comité de Salut Public sur les idiomes, les dangers que constitue, pour la République, l’existence de ces "idiomes" :
Citoyens, les tyrans coalisés ont dit : l'ignorance fut toujours notre auxiliaire le plus puissant ; maintenons l'ignorance ; elle fait les fanatiques, elle multiplie les contre‑révolutionnaires ; faisons rétrograder les Français vers la barbarie : servons‑nous des peuples mal instruits ou de ceux qui parlent un idiome différent de celui de l'instruction publique [...]. Le fédéralisme et la superstition parlent bas‑breton ; l'émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre‑révolution parle l'italien et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d'erreur (cité par Certeau-Julia-Revel 1975 : 291).
On prend alors des mesures diverses : on devait nommer, dans les dix jours, des instituteurs (qui ne soient pas ministres du culte) et les envoyer dans tous les départements où l’on parlait italien, basque, allemand ou bas‑breton, afin qu’ils enseignent la langue française et la Déclaration des Droits de l’Homme aux jeunes citoyens des deux sexes (que leurs parents sont tenus d’envoyer dans les écoles publiques). C’est aussi le moment de la terreur linguistique en Alsace, où sont décrétées des mesures spéciales : interdiction d’employer une autre langue que le français dans toute manifestation publique, dans les inscriptions des édifices publics (les inscriptions existantes seront effacées), etc.
Quant aux "patois", on les considérait moins comme un danger que comme une gêne qui ne remettait pas en cause la sécurité de la République. Leur destruction était cependant nécessaire aux yeux de beaucoup…
L'unilinguisme : une idéologie linguistique
La Révolution française et ses visées en matière glottopolitique, bien que non abouties immédiatement, ont contribué de façon décisive à installer une idéologie sociolinguistique particulièrement coercitive dans l'imaginaire collectif des Français, que l'École républicaine, tout particulièrement, se chargera de mettre en œuvre "pédagogiquement". H. Boyer a analysé dans plusieurs publications (en particulier dans Lengas, n°48 / 2000 : 89-101) la construction de cette idéologie et son impact.
Boyer considère que l’histoire sociolinguistique (et donc glottopolitique) du français est traversée par une quête inflexible, celle de l’unilinguisme. Avec l'utilisation du mot unilinguisme (et non monolinguisme), ce qu'il veut souligner c'est le résultat d’un processus qui a tendu à imposer, le plus souvent par une violence symbolique efficace (Bourdieu 1976), l’unicité sur deux plans : le plan interlinguistique et le plan intralinguistique.
Examinons ces deux aspects de l’unilinguisme français, que l’on peut résumer par la formule : ni concurrence (pour la langue nationale), ni déviance (par rapport à l’usage légitime).
Pas de concurrence
La traduction de l’unilinguisme ici, c’est bien entendu l’unification linguistique du territoire, qui coïncide avec l’histoire sociolinguistique de la France et qui se confond avec la construction de l’État national commencée sous la Monarchie (dès ses débuts), mais accélérée sous le régime républicain, à partir de la Révolution. Cette histoire, c’est l’histoire d’une domination linguistique qui a connu plusieurs phases, depuis un état de plurilinguisme effectif (et de concurrence sociolinguistique ouverte, en particulier dans le domaine littéraire pour ce qui concerne la langue d’oc) jusqu’à un état contemporain de quasi monolinguisme […] en passant par divers stades de pluridiglossie.
On mentionne souvent, comme date du déclenchement de la politique d’unification linguistique de l’ État monarchique français, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François 1er en 1539. En réalité, il s’agit d’un repère plutôt administratif mais devenu effectivement date symbolique : plusieurs études consacrées à cette période en domaine occitan ont montré qu’avant 1539, la majorité des actes notariaux étaient rédigés en français et non plus en latin ou en vernaculaire (voir par exemple Nacq 1979). En fait, c’est bien la Révolution française qui est le moment-clé de la légitimation d’une unification linguistique en faveur du français (Boyer et Gardy, éd. 1985 ; Schlieben Lange 1996)
On l'a dit plus haut, dans un premier temps, en 1790, les Décrets de l’Assemblée sont traduits dans les diverses langues de France (cf. l’entreprise Dugas dans le Sud) et qu’une importante production textuelle de type propagandiste publiée dans ces langues apparaît un peu partout, singulièrement en domaine occitan (voir Boyer et al. 1989). Cependant, au même moment, l’Abbé Grégoire lance sa célèbre enquête (“une série de questions relatives au patois et aux mœurs des gens de la campagne”) dont l’objectif fondamental est clairement énoncé au détour d’une des questions (la question 29) : “détruire entièrement le(s) patois” (De Certeau, Julia et Revel 1975).
Ce mot de “patois” venait d’être consacré par l’Encyclopédie comme un désignant discriminatoire, stigmatisant pour les langues de France autres que le français, seule langue reconnue “nationale”. En réalité, avec son enquête, non seulement Grégoire cherche à prendre toute la mesure de la pluralité sociolinguistique, mais il condamne à terme cette pluralité comme obstacle à une communication politique satisfaisante, obstacle donc à la Révolution. Son rapport de mai 1794, authentique déclaration de politique linguistique, développe d’une certaine façon l’objectif déjà inscrit dans l’enquête de 1790, de manière encore plus explicite. L’intitulé est on ne peut plus clair : “Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française” (voir texte commenté)....
Ce texte est une pièce de première importance dans la quête de l’unilinguisme :
1. Il illégitime le pluralisme linguistique. La pluralité, en la matière, c’est le désordre. Grégoire parle de 30 “patois” différents. Il ajoute pour frapper les esprits que dans les contrées méridionales, “le même cep de vigne a trente noms différents”... Cette pluralité désordonnée s’oppose à l’ “usage invariable” du français.
2. Il illégitime le pluralisme linguistique du point de vue fonctionnel, du point de vue communicationnel. L’usager du seul “patois” ne peut pas communiquer avec tous les citoyens. De même, les “patois dressent des barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales”. Qui plus est, l’accès au nouveau langage politique fait problème car “si dans notre langue [= le français, seul digne de cette dénomination] la partie politique est à peine créée, que peut-elle être dans des idiomes [qui] sont absolument dénués de termes relatifs à la politique”...
3. La seule langue légitimée est donc le français, pour des raisons fondamentalement politiques : c’est “la langue de la liberté”, la seule qui permette de “fondre tous les citoyens dans la masse nationale” à la différence des “idiomes féodaux” : le français est la langue de l’ordre nouveau, révolutionnaire, les patois sont des survivances de l’ordre ancien. On sait que cet argument sera longtemps invoqué.
Pas de déviance
Il s’agit de l’autre face de l’unilinguisme français, complémentaire de la lutte permanente (et efficace à partir de la fin du XIXe siècle) pour l’unification linguistique : l’obsession de l’uniformisation de l’usage de la langue, par le respect scrupuleux d’une norme unique, du Bon Usage. Et du reste, ce n’est pas un hasard si l’Ordonnance de Villers-Cotterêts est édictée durant les débuts de ce que l’on considère comme la période de standardisation de la langue française, que D. Trudeau (Trudeau 1992) fait aller de 1529 (date de la publication de Champ Fleury de Geoffroy Tory) à 1647 (date de la publication des Remarques sur la langue française de Vaugelas). C’est donc en France la période où s’opère le processus sociolinguistique que S. Auroux appelle grammatisation, “processus qui conduit à décrire et à outiller une langue sur la base de deux technologies, qui sont encore aujourd’hui les piliers de notre savoir métalinguistique : la grammaire et le dictionnaire” (Auroux (éd.) 1992 : 28).
Ce processus, fondateur de toutes les langues modernes, du moins les langues occidentales, s’est développé en France de manière très particulière. On peut dire que la standardisation (la normativisation) a subi dans ce cas une dérive : au lieu d’installer des normes grammaticales, lexicales, orthographiques... ouvertes, indispensables à la maturité de la communauté linguistique, à la normalisation de ses usages (Aracil 1965, Boyer 1987) on a sacralisé une norme du français, on a idéalisé un usage puriste de la langue, on a institutionnalisé - et donc solidifié - le Bon Usage, et ce, bien entendu, en phase avec la confirmation d’une tendance profonde à l’unification linguistique en faveur du français. Le fétichisme de la langue, dénoncé par Bourdieu et Boltanski (1975), est bien l'une des spécificités de l’imaginaire collectif des Français (un authentique Sur-Moi sociolinguistique) : il est le produit d’une construction idéologique nommée ici unilinguisme. On peut considérer, à la suite de ce qui vient d’être observé, qu’elle est constituée de quelques représentations linguistiques partagées, parfaitement solidaires (Boyer 1990 ; voir également Martinet 1969, Gardy et Lafont 1981, Decrosse 1986, Knecht 1993, Eloy 1993, Houdebine 1994, Leeman Bouix 1994), qui peuvent être ainsi identifiées :
- une représentation hiérarchique des langues historiques, selon laquelle seules certaines langues (le français en tout premier lieu) seraient dotées d'un "génie" et auraient plus que d'autres le droit d'être utilisées sans limitation d'espace ni de domaine et auraient donc vocation à "l'universalité". Bien entendu, selon cette représentation, langue s'oppose à dialecte ; la plus basse des "conditions" (linguistiques) étant en France le patois (c'est-à-dire en fait une non-langue) ;
- une représentation politico-administrative de la langue, qui, pour ce qui concerne le français, confond langue "nationale" et langue "officielle", ne tolère qu'un autre statut (d'une classe politico-administrative inférieure), celui de langue "régionale" (voire "locale") et qui a obtenu récemment une légitimation constitutionnelle avec le fameux énoncé de 1992 concernant l'article 2 : "La langue de la République est le français" ;
- une représentation élitiste (fantasmée) de la langue: LE français, qui considère que l'état de perfection (et de beauté) qu'aurait atteint cette même langue ne cesserait de se dégrader. D'où l'obsession puriste d'un "bon usage" (de nature profondément scripturale) qui vise à exclure la variation / l'hétérogénéité (pourtant inhérentes à une activité linguistique collective normale) sous diverses désignations stigmatisantes : "charabia", "petit nègre"… ou à les juguler par rejet à la périphérie à l'aide d'une opération de repérage-codification. La langue est ainsi posée comme idéalement immuable, inaltérable, indépendante pour ainsi dire de la communauté d'usagers, une langue dont l'intégrité est sans cesse menacée de l'intérieur par ses usagers (certains ? la plupart ? de plus en plus ? les jeunes surtout ?) et aussi de l'extérieur (par les emprunts, par exemple, dans la dernière période, les emprunts à l'angloaméricain).
Ces trois représentations de base (il s'agit d'un dispositif minimal auquel peuvent s'intégrer d'autres représentations "associées") s'articulent donc pour constituer une idéologie dont la vocation a été/est de promouvoir l'unilinguisme dans ses deux orientations solidaires : interlinguale et intralinguale.
En quoi la situation linguistique de la France a-t-elle changé après la période révolutionnaire ?
Il est évident que les ambitieux projets des révolutionnaires ne furent pas menés à bien ; la politique contre les "patois" était inopérante dans la mesure où il n’était pas vraiment possible d’organiser une école en français car on manquait d’instituteurs parlant français. Mais les effets qui s’ensuivirent furent importants : à la fin de la Révolution, le nombre de francophones, certes déformant plus ou moins la langue, était bien supérieur à celui de 1789 ; les "patois" et les "idiomes" n’étaient pas éliminés mais la langue nationale ("la langue de la République", désormais la seule légitime) avait réussi à s’introduire dans des endroits où elle n’avait jamais été. S’appuyant sur des documents, F. Brunot (Brunot 1967, t. IX, 1re partie : 417-419) soutient que, à la fin de la période révolutionnaire, toute la population comprenait le français et qu’une grande partie le parlait ; là où les "patois" étaient conservés, ils se rapprochaient de plus en plus du français et se cantonnaient dans les villes de peu d’importance, dans les quartiers d’ouvriers ou de pêcheurs. Concernant par exemple le département de la Haute-Garonne, voici ce qu’il en est dit de sa situation linguistique :
Dans les villes et dans tout le pays qui les entoure, l'idiome vulgaire subit peu à peu des changements qui le rapprochent de la langue nationale. Ce qu'on peut attribuer au mélange fréquent des habitants des divers pays, soit dans les armées et les levées en masse, soit dans les réunions politiques. [...] On a senti partout le besoin d'entendre et de parler le français. Il faut dire aussi que l'instruction qui consiste à savoir lire, écrire et compter s'est un peu étendue dans les campagnes depuis quinze ans. Ce qu'il y a de certain, c'est que les personnes qui parlent le français avec un mélange plaisant de mots et de tours gascons et avec cet accent qui excite le rire dans les spectacles sont devenues plus rares à Toulouse et sans doute aussi dans les autres villes de cette contrée. Un comédien qui viendrait chercher ici des modèles en ce genre en trouverait moins aujourd'hui et de moins saillants qu'autrefois (Bastide, Conseiller de Préfecture de la Haute-Garonne, 21 avril 1810, B.B. ms., Nouv. acq. fr. 5911, fos 14 et 15, cité par Brunot 1967, t. IX, 1re partie : 418).
Des témoignages divers montrent que le déclin des usages oraux des langues de France autres que le français, jusque-là en partie préservés, est enclenché et que la transmission commence à s’interrompre. Une chanson en francoprovençal composée au XIXe siècle par un ouvrier de la soie (un canut) appelé Guinamard et originaire du village de Bessenay (dans les Monts du Lyonnais) à l’occasion de l’épidémie de phylloxéra qui a touché la région et la France vers 1885, fait état de cette évolution (nous reproduisons deux strophes de ce chant reccueilli dans l'Atlas sonore Rhône-Alpes, n°22, CMTRA 2012) :
Je voudrin que tartui comprènon
Ce que tié je voué marmotô
Et qu’ou sorié chôcun zou preno
In patois je voué zou chantô
Ce langajo que noutron grand-père
L’in toujor parlô dé iou tin
Vore zeteu moin bien mious à rére
Si chocun fase comme y tienJe voudrais que comprennent
Ce qu’ici je vais murmurer
Et qu’au sérieux chacun me prenne
En patois je vais chanter
Ce langage que nos grands-pères
Ont toujours parlé en leur temps
Maintenant, ce serait bien moins facile
Si chacun faisait comme cela
Vorindran que tote le vigne
Son bien malade de perteu
E ne fô pô que lo mondo crégno
D’in achité pe replantô
D’éporti de plan d’Amerique
Lo gôméré los an très bien
O sereu lo vin de fabrique
Si chacun fase comme y tienA présente que toutes les vignes
Sont bien malades de partout
Il ne faut pas que les gens craignent
D’en acheter et d’en replanter
D’importer des plants d’Amérique
Les gamérelles le savent bien
Ce serait le vin de fabrique,
Si chacun faisait comme cela
L’école de Jules Ferry (1881)
On l’a dit, les ambitieux projets éducatifs énoncés durant la Révolution n’ont pas pu aboutir, faute de moyens matériels et humains. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que l’école devienne obligatoire, laïque et universelle (Lois Ferry). La langue française devient alors tacitement "la" langue de cette école, dans laquelle il n’y a pas de place pour les "autres langues maternelles", langues que l’on ne nomme même pas :
Une première constatation s'impose : les textes officiels sont pratiquement muets sur la question de la langue. Elle n'apparaît que dans le règlement intérieur type proposé par le Ministère en 1881, et adopté ensuite par les départements. On trouve là un article 14 ainsi libellé : "le français est seul en usage dans l'école". C'est l'article le plus court de tout le texte. Et si Jules Ferry a éprouvé le besoin de gloser certains autres éléments de son règlement, celui-là ne pose visiblement aucun problème. […]
Nulle part, les langues alternatives ainsi écartées ne sont nommées, fût-ce sous l'appellation englobante et péjorative de "patois". D'entrée de jeu le règlement installe l'évidence d'une école monolingue par nature. Les textes ultérieurs ne seront pas plus explicites. Une circulaire sur les écoles maternelles de 1883 se borne à donner comme consigne aux maîtresses : "corriger les défauts de prononciation ou d'accent local" des enfants (Martel 1997 : 101-102).
Mais si dans les textes officiels ces langues ne sont pas nommées, les exemples de Règlement disciplinaire qui y font allusion ne manquent pas : voici un article de celui des écoles des Basses-Pyrénées (1881)
Article 9:
RÉCRÉATIONS: Les chants isolés et les cris bruyants sont interdits pendant les récréations. Il est rigoureusement défendu de parler patois et de proférer des paroles que répudie la bonne éducation…

Bibliothèque de Toulouse (Rosalis)
Bien que, comme le rappelle Ph. Martel, la politique de l’école varie selon les époques et selon les lieux, dans les faits en quelques années la généralisation de l’enseignement va mettre un terme à l’existence des locuteurs monolingues en langues autres que le français et entraîner une disparition progressive de ces langues dans les usages oraux (disparition déjà bien entamée dans les usages écrits).
Cependant, il est vrai que certains instituteurs, à contre-courant, se sont servis des langues maternelles pour mieux enseigner le français, pratique qui, dans un premier moment, semble avoir été tolérée.
La politique d’enseignement de la langue nationale dans beaucoup d’écoles fut accompagnée de la stigmatisation des "autres langues de France", désignées péjorativement par le terme patois. Dans beaucoup d’écoles on a appliqué ce que l’on appelle le signal ou le symbole, une "pratique pédagogique" d’une grande efficacité, car les propres élèves devenaient les gardiens de la langue française ainsi que la décrit F. Broudic :
la surveillance mutuelle des élèves les uns par les autres, la remise d’un objet symbolique à celui qui était surpris à parler la langue locale, le dialecte ou le "patois", et enfin la punition infligée en fin de journée (Broudic 2013 : 354).
Punition qui variait selon les écoles. F. Broudic (ibid. 363) fait l’inventaire de quelques-unes de ces punitions : "rester le soir une heure pour écrire dix ou vingt lignes, parfois cent", copier des phrases comme "je ne parlerai plus patois" à tous les temps de l’indicatif… mais aussi rester après les cours pour balayer la classe, nettoyer les toilettes, être privé de recréation et être mis au piquet ou réciter le chapelet (dans les écoles catholiques)…
Comme le rappelle Pierre Escudé "l’école républicaine n’a jamais imposé ni dénoncé de manière systématique et globale cet usage" (Escudé 2013 : 341). Ceci dit, cette pratique n’a pas fait l’unanimité : Irénée Carré, inspecteur général de l’Enseignement primaire, auteur d’une méthode qui fut choisie par les pouvoirs publics pour franciser les petits Bretons à compter de la fin des années 1880, écrivait à propos du signal :
Singulier moyen de leur apprendre une langue et de la leur faire aimer ! Singulier moyen d’éducation aussi que cet espionnage continuel, avec ces délations qu’il amenait nécessairement. "La Basse-Bretagne. Ses habitants, ses mœurs, ses usages, ses écoles", Annuaire de l’enseignement primaire, Paris, Armand-Colin, 1891, pp. 467-499. [cité par Puren 2003 : 35]
La conséquence de cette pratique dans le domaine occitan, par exemple, sera l’interruption de la transmission linguistique intergénérationnelle, fruit d’
un sentiment de culpabilité maximal […] souvenir d’une lutte scolaire contre l’occitan (non encore éteinte) : trace du traumatisme subi à l’ entrée à l’école par des garçons et des filles qui y prenaient le premier contact avec le français et étaient souvent punis pour ne pas le comprendre ni le pratiquer ; peur constante de mal parler le français ; sentiment de relégation sociale alourdi d’un malaise économique, de la pauvreté […] La culpabilité se révèle au blocage immédiat de l’occitanophonie […]. Elle se développe dans le refus de parler occitan aux enfants et aux femmes (Lafont 1981 : 97)
